Cet essai ne paraît pas dans la version papier du magazine.
Le retrait gradué – ou l’éjection par à-coups – de la France du Sahel, d’abord du Mali, puis du Burkina Faso, et enfin du Niger, est un fait similaire au départ précipité des États-Unis de l’Afghanistan, départ qui, fut, lui aussi, une éjection. Comme l’explique un article récent du magazine américain The Atlantic, lorsque Joe Biden a décidé de retirer ses troupes d’Afghanistan, il ne pensait nullement que cela entraînerait une rupture avec ce pays : « Ce serait une fin, mais pas la fin. Au sein du département d’État, il y avait une conviction bien ancrée : même après le 31 août, l’ambassade à Kaboul resterait ouverte. Son personnel ne serait pas aussi nombreux, mais certains programmes d’aide se poursuivraient et les visas seraient toujours délivrés. Les États-Unis – du moins le département d’État – n’allaient pas abandonner le pays. » Lors de la mise au point du plan de retrait, il était entendu que le gouvernement afghan soutenu par Washington resterait en place et serait en mesure de résister aux assauts des Talibans des mois après le départ des troupes américaines. L’armée afghane avait été formée et équipée, et un appui logistique léger des Américains renforcerait sa force de frappe et sa résilience. Mais à la surprise des Américains, la résistance de l’armée régulière afghane s’effondra rapidement après l’annonce du programme de retrait, si bien qu’ils furent pris de court et se retrouvèrent pratiquement assiégés dans Kaboul. Leur départ ressembla à une fuite et un abandon, nullement au repli ordonné suivi d’une période d’appui et de soutien qui avait été programmé.
Ce désastre provenait du fait que l’Afghanistan, tel que postulé par les stratèges américains, à savoir un État-nation cohérent et possédant une élite attachée à l’intégration au pacte occidental et prête à en découdre pour maintenir cette intégration, n’existait tout simplement pas. Une frange de la population afghane, notamment les femmes instruites, appréciait l’avenir que l’Amérique et l’Occident proposaient à leur pays, mais la grande majorité était soit hostile soit, le plus souvent, indifférente. Quant aux élites, elles étaient plus préoccupées par les luttes de pouvoir et le contrôle des rentes que par un quelconque projet national. Seuls les Talibans étaient en possession d’un tel projet, et ils étaient prêts à mener une lutte de longue haleine et à accepter tous les sacrifices afin de parvenir à le mettre en œuvre. Face à cette détermination acharnée que donne le flamme idéologique, renforcée par des décennies d’expérience militaire, l’armée régulière afghane, motivée uniquement par de fluctuants intérêts matériels ou tout au plus claniques, ne faisait pas le poids. C’est en Ukraine que les États-Unis ont finalement trouvé le type d’entité politique capable de profiter de leur assistance militaire. Sans avoir de troupes sur le sol ukrainien, leur investissement sur ce terrain a payé dans le sens où la petite Ukraine a réussi à bloquer le rouleau compresseur russe et à lui faire revivre des affres similaires à celles que l’Union soviétique a connu lorsqu’elle s’en est prise… à l’Afghanistan, dans les années 1980.
Le Sahel a souvent été comparé à l’Afghanistan. C’est une région musulmane dans son écrasante majorité, ayant de forts taux d’extrêmes pauvreté et assaillie par des bandes djihadistes qui menacent, de façon pas tout à fait crédible, de s’emparer des États afin de mettre en place un type de gouvernement semblable à celui des Talibans. Dans les zones tombées sous l’emprise de ces combattants, les règles de vie rappellent celles en vigueur, aujourd’hui, en Afghanistan. À l’instar de l’Afghanistan, les pays du Sahel ne sont pas des États-nations cohérents. Il n’existe notamment pas de contrat social fonctionnel entre l’État et la population, et si les élites ont effectivement recherché une place au sein du pacte occidental, cela a généralement été (surtout à partir des années 1990) dans le but de réduire davantage leurs responsabilités vis-à-vis de la population, notamment en laissant au régime de l’aide la fourniture de nombreuses catégories de biens publics destinées à la majorité pauvre de ladite population. Cette aide, fournie essentiellement par les pays occidentaux, est donc devenue de l’assistance sociale et humanitaire plutôt qu’une authentique aide au développement. Historiquement, l’aide au développement est une conséquence, non une cause de la dynamique de développement : or une telle dynamique ne peut être impulsée que de l’intérieur, et les leaderships sahéliens ont cessé de la stimuler depuis au moins la fin des années 1980. La lutte pour le pouvoir et le contrôle des rentes est ainsi devenue la principale préoccupation des leaderships, surtout avec la démocratisation, dans les années 1990, dont l’un des effets pervers a été la production d’une classe politique composée en majorité d’acteurs opportunistes, motivés par des intérêts élitaires.
De même que les Américains ne pouvaient pas mobiliser le gouvernement afghan pour sa propre défense, les Français échouèrent à organiser les gouvernements sahéliens pour la leur, et pour à peu près les mêmes raisons. Ils ont des responsabilités dans cet échec. L’aide américaine en Afghanistan a été, par exemple, marquée par des niveaux grotesques de corruption ; et les Français ont longtemps essayé d’imposer leur vision des choses sans tenir compte des susceptibilités et agendas locaux, compliquant ainsi davantage une situation déjà épineuse. Mais dans les deux cas, l’échec découle au final de l’absence de volonté politique chez les gouvernants locaux, aussi bien à Kaboul que dans les capitales sahéliennes. La volonté politique se mesure par les actes. Les Sahéliens reprochent, par exemple, aux Occidentaux d’avoir plus fait pour l’Ukraine que pour eux : c’est exact, mais la mesure de leur trempe ne devrait pas être ce qui a été fait pour eux, ce devrait être ce qu’ils ont fait de ce qui a été fait pour eux, aussi modique soit-il. On aide toujours mieux celui qui sait se faire aider.
Les résultats militaires obtenus par les Français au Sahel sont similaires à ceux des Américains en Afghanistan : là où ils ont été présents, ils ont contenu l’ennemi sans réussir à le vaincre. La situation opérationnelle était significativement différente. Si les Talibans sont des adversaires plus redoutables que les djihadistes du Sahel, les Français n’ont réellement combattu ces derniers que dans le nord du Mali. Ils n’intervenaient pas au centre du Mali, dont les campagnes sont tombées progressivement aux mains des djihadistes. Au Burkina Faso, leur liberté de manœuvre était très réduite même à l’époque du gouvernement civil de Roch Kaboré : or l’est du Burkina et le secteur de Dori en particulier étaient (et restent) un poumon économique pour les groupes djihadistes, que le gouvernement burkinabè ne réussissait pas – et ne réussit toujours pas – à sécuriser. La présence française au Niger était insignifiante jusqu’en 2022 et, par la suite, soumise à restrictions après le transfert de Barkhane dans ce pays. De ce fait, l’action française au Sahel était plus contrainte et embarrassée que celle des Américains en Afghanistan, et les condamnait à un travail qui revenait à vider le tonneau des Danaïdes.
Ces restrictions provenaient de la prudence politique des gouvernants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, conscients de l’hostilité croissante de leurs opinions publiques à l’encontre des Français. D’une certaine façon, cela revint à condamner les Français à l’inefficacité qui leur était reprochée, sans que cela ait empêché les putschs qui ont renversé les uns après les autres les gouvernants en question. En conséquence, alors que les Américains ont été chassés par l’ennemi qu’ils étaient venus combattre, les Français l’ont été par une force dont ils ne se considéraient pas ennemi. Au Sahel, ce sont les forces armées locales qui ont fait ce que les Talibans ont accompli en Afghanistan : détruire le gouvernement établi et chasser son allié occidental.
*
Si la pertinence de la comparaison ne sauterait pas aux yeux de la plupart des observateurs, ce parallélisme est plus significatif qu’il n’y paraît.
À première vue, les putschs ne comportent pas, comme la guerre des Talibans, un projet idéologique, et l’éviction de la France semble découler du simple fait qu’elle était, au Sahel, l’ancienne puissance coloniale, coupable – on l’imagine – de nombreux erreurs et errements liés à ce statut. En réalité, cependant, les putschs du Sahel comportent une forte dose d’idéologie ; et la France s’est attirée l’hostilité et parfois la haine des Sahéliens en raison du rôle qu’elle joue dans cette idéologie, et non des erreurs qu’elle a effectivement commises au cours de son action récente dans la région, erreurs que ses accusateurs locaux évoquent rarement, voire jamais.
Il est important de comprendre ce point, en particulier parce qu’il permet de rendre compte du fait qu’en dépit de mon usage du terme généralisateur « les Sahéliens » (voir le paragraphe précédent), l’opinion publique, dans ces pays, est hétérogène ; cette hostilité ou cette haine dont je parle n’y est pas universelle (il y reste encore des francophiles) ; et elle varie, dans sa nature, suivant les types d’opinion. Elle peut avoir de douteuses origines partisanes ou s’enraciner dans la tradition plutôt saine de la méfiance des anciens colonisés envers l’ancien colonisateur. Mais dans la séquence actuelle, sa variante idéologique a pris le dessus, peut-être momentanément. On parle parfois, à ce sujet, de « souverainisme » ou, comme l’a fait Achille Mbembe dans un essai récent pour le Grand Continent, de « néosouverainisme », mais le terme le plus approprié est sans doute « néonationalisme », utilisé pour la première fois dans ce contexte, autant que je sache, par l’expert en sécurité Issaka Ouédraogo (dans une communication orale). « Néo » par rapport à l’ancien nationalisme des années 1960, ainsi qu’au fait que le contexte actuel est très différent de celui de cette période ancienne, qui fut marquée par les luttes de libération nationale et de décolonisation. Aujourd’hui, pour reprendre la formule de Marx selon laquelle l’histoire se répète d’abord comme tragédie puis comme farce, il n’y a pas de lutte de libération nationale, mais les néonationalistes mettent néanmoins un tel concept en scène, et tirent une satisfaction sentimentale à chasser les Français.
Le néonationalisme n’est pas une idéologie exclusivement sahélienne. On en trouve des expressions dans d’autres parties du continent ou ailleurs dans le monde. Le « monde russe » de Vladimir Poutine, en tant que réhabilitation du nationalisme slavophile dans un contexte différent de celui de son apparition initiale, correspondrait à la définition du néonationalisme indiquée plus haut. En Afrique, il est cependant bien plus hétéroclite qu’à Moscou dans la mesure où il est difficile qu’une idéologie nationaliste s’ajuste aux dimensions d’un vaste continent marqué par la diversité de cultures et de religions. Il possède quelques chapelles identifiables, comme les kémétistes, qui assurent pratiquer la religion et la culture des anciens égyptiens, ou les panafricains, qui se réclament des héros prophétiques de la libération nationale (Nkrumah, C. A. Diop, Thomas Sankara). Il possède également une vision générique partagée par tous et qui n’est pas, en tant que telle, du néonationalisme : la renaissance de l’Afrique à travers ses valeurs, ses ressources et ses intérêts. On peut parler ici d’un patriotisme africain « naturel », c’est-à-dire non-idéologique. Mais dès qu’il s’agit de préciser la nature de ces valeurs et de ces intérêts les tensions apparaissent entre les diverses chapelles, renforçant aussi bien les voix idéologiques que les divisions entre elles : néonationalistes d’obédience musulmane, chrétienne, ou traditionnaliste ; Sub-Sahariens versus Nord Africains. Invité au Niger le 25 septembre par l’organisation néonationaliste Urgence Panafricaniste, l’activiste Kémi Séba s’est aussitôt trouvé en butte à une campagne de presse locale qui met en épingle ses déclarations contre l’islam. En octobre de l’année dernière, un jeune kémétiste malien s’est filmé en train de fouler au pied un exemplaire du Coran en prononçant le salut kémétiste, « Hotep ! », car du point de vue kémétiste, l’islam est « le premier colonisateur » de l’Afrique.
Mais l’ennemi commun, l’Occident, permet de fédérer ces chapelles. Ainsi, pour les néonationalistes musulmans, cette figure est tout à la fois chrétienne, juive et laïque, trois têtes d’une même hydre ; pour les panafricains de langue anglaise, il s’agit surtout des États-Unis, et pour ceux de langue française, il s’agit exclusivement de la France. Au Sahel, la prévalence de l’islam force les néonationalistes à métisser le panafricanisme d’islam – l’opération inverse, mettre du panafricanisme dans l’islam, n’étant cependant pas possible (le « pan » de l’islam concerne la Oumma, pas l’Afrique). Incidemment, cela empêche aussi les néonationalistes de qualifier de « djihadistes » les combattants de Al Qaeda et de l’État islamique qui affirment pourtant être engagés dans un djihad. Les locutions le plus souvent en usage dans les pays concernés sont « terroristes » et « bandits » en français ; et dans les langues locales, un équivalent de « malfaiteurs ». Comme la France est accusée d’être à la tête de ces malfaiteurs, il serait incongru d’affirmer qu’un État chrétien et laïc serait responsable d’un djihad.
*
À la faveur du djihadisme sahélien et de l’intervention française qu’il a occasionné, le néonationalisme est devenu, pour la première fois en Afrique, une force politique. C’est lui qui a défini, pour les populations sahéliennes, la situation actuelle comme une guerre de la France contre le Sahel et a ainsi directement causé la chute des gouvernements qui travaillaient avec elle et l’éviction subséquente de la France. Le poids de cette propagande est mal compris par les observateurs extérieurs, ce qui peut d’ailleurs se comprendre : le néonationalisme ne pèse pas très lourd en lui-même. Mais son importance a été accrue et rendue plus virulente par ses usages politiques, notamment pour des acteurs aussi importants que les militaires et certains opposants politiques. De ce fait, l’histoire de son essor et de son triomphe dans la région est assez simple.
Le Sahel ne s’étudie malheureusement guère lui-même. Face à cette crise énorme, existentielle même, qu’est le conflit djihadiste, les pays n’ont pas généré les produits intellectuels capables d’éclairer l’opinion – ne serait-ce que celles des couches instruites – sur base de preuves et de théories explicatives afin de débattre des solutions à apporter. Les explications simples qui jouent sur les émotions et incarnent les problèmes dans des individus ou des entités concrètes, ont donc tendu à s’imposer tout naturellement. Bien que toujours réducteur, ce type d’explication n’est pas nécessairement faux. Cependant, il est le vecteur idéal du populisme et de la propagande, qu’ils soient idéologiques ou simplement politiques. Par ailleurs, au cours des années 2010, ce vecteur s’est avéré extrêmement contagieux grâce à l’explosion des médias sociaux, en particulier WhatsApp et plus récemment TikTok, qui permettent de faire circuler de manière massive et accélérée des images et vidéos choc de provenance peu claire et des messages vocaux souvent anonymes – lesquels, par un phénomène psychologique qui, je l’imagine, a un nom, paraissent plus véridiques parce qu’ils sont véhiculés par de la technologie, alors qu’ils n’ont, la plupart du temps, pas plus de valeur qu’un propos tenu dans la rue par un quidam ou, comme on dit dans le français du Niger, « un badaud ».
Les médias sociaux sont particulièrement redoutables par la manière dont ils enferment les personnes dans des bulles de « pensée unique » constituées par un effet d’écho en continu, ainsi que par leur capacité à véhiculer et diffuser les énergies négatives. Leur rôle amplificateur dans les persécutions de masse ou les conflits, par exemple le génocide des Rohingya au Myanmar ou les tensions ethniques en Éthiopie a été bien documenté. En ce qui concerne la fixation antifrançaise du néonationalisme sahélien, ils se sont révélés un don du ciel quand il s’est agi de répandre et de diffuser cette vision des choses dans un vaste public sous-informé et dépourvu de défenses d’esprit critique (ce dernier trait est loin d’être une particularité sahélienne, bien entendu). Le fait que les propagandistes russes ont été enrôlés dans l’effort n’est pas un détail anodin, mais la Russie est ici, comme dans d’autres situations, un facteur aggravant, de l’huile sur le feu, non une cause.
Grâce à ce vecteur, les « explications » néonationalistes de la crise sécuritaire sahélienne sont arrivées sur le marché de l’opinion publique sahélienne très tôt. Personnellement, j’ai commencé à les entendre vers 2011, lorsque je faisais des recherches sur Boko Haram au Nigeria et au Niger. De part et d’autre de la frontière, j’eus la surprise d’entendre, à plusieurs reprises, l’assertion selon laquelle Boko Haram était une création des États-Unis (côté Nigeria) ou de la France (côté Niger). À l’époque, je fus vaguement intrigué, mais ne prêtai pas davantage attention à ce que je supposai être une simple et passagère théorie conspirationniste. Mais au long de la décennie, je m’aperçus qu’il s’agissait, en réalité, d’un mème idéologique qui émanait d’un discours très construit, source d’une grille de lecture générique, un « script » (scénario qu’on peut utiliser en toutes circonstances) qui s’avéra utile pour les personnes en quête d’explications digestes. Les contradictions de ce script sautent aux yeux, mais les discours idéologiques font partie de ces choses dont on ne voit les défauts que de l’extérieur. Or, au Sahel, une bonne partie de la population est à l’intérieur dudit discours. La conscience sahélienne, plus ou moins fortement marquée par la longue histoire de la domination occidentale et par les rapports radicalement inégalitaires qui existent entre la région et l’Occident, est biaisée en faveur d’une interprétation des choses qui blâme une entité que son excessive puissance place, à tort ou à raison, au rang de coupable naturel. Cela fut d’autant plus le cas que le visage pris, en l’occurrence, par ce coupable naturel est celui de la France, pays envers lequel les causes de rancœur et de ressentiment ne manquaient pas. Le succès fut donc immédiat et les gens s’engouffrèrent dans cette explication providentielle de leur problème un peu, il faut bien le dire, à la façon du proverbial mouton de Panurge.
Les choses auraient pu en rester là, au niveau d’une sorte de fièvre intermittente de l’opinion publique qui fermente dans les grins et fada (les discussions de comptoir à la sahélienne, dont l’influence sur les consciences collectives ne saurait être surestimée), si la popularité évidente de ce script n’avait fini par le transformer en denrée politique très recherchée, notamment pour deux types d’acteurs, les politiciens en panne de carrière, et les militaires à l’affût d’un putsch.
*
Les militaires sahéliens sont les grands vaincus de la crise sécuritaire. Ils n’ont pas pu empêcher les énormes pertes de territoire (au Mali et au Burkina en particulier) et ont été les premières victimes aussi bien de la force de frappe des djihadistes que de la corruption qui gangrenait les cercles militaro-politiques. Le partenariat avec l’armée française a été, pour nombre d’entre eux (notamment les officiers), une source d’intense humiliation face aux ressources dont ces troupes disposaient ou au fait qu’elles semblaient bénéficier d’exorbitants privilèges politiques d’accès et de mouvement. L’idée que ces alliés « arrogants » étaient en fait des ennemis présentait un triple avantage : (1) elle permettait de soulager le sentiment d’humiliation inspiré par leur évidente supériorité ; (2) elle justifiait l’armée de sa défaite, puisque l’ennemi n’était plus un simple « broussard » à moto armé de sa kalach mais une des premières puissances militaires du monde ; et (3) elle autorisait la prise du pouvoir face à un gouvernement civil acquis à l’ennemi.
Les hiérarchies militaires du Sahel, bien que conscientes de la fausseté de cette accusation, ont délibérément encouragé sa propagation aussi bien dans les rangs – où nombre de soldats jurent avoir aperçu des Français œuvrant en appui à leurs assaillants – que (une fois arrivées au pouvoir) au sein du grand public. Cette propagande continue à ce jour. Par exemple, l’éditorialiste du bien-nommé périodique malien Le National assure le public, dans sa livraison du 21 septembre 2023, que la France aurait ourdi l’attaque, par les djihadistes, du bateau Le Tombouctou qui transportait des passagers et des marchandises vers la ville du même nom : « Les ennemis de la patrie, pions des puissances maléfiques comme la France d’Emmanuel Macron, ont plongé la patrie dans un immense deuil en attaquant dès la première semaine de ce mois de septembre le bateau Tombouctou, navire marchand et non de guerre, avec une horreur indescriptible ». La junte nigérienne a, à plusieurs reprises, diffusé des communiqués sibyllins signalant la présence de militaires français au milieu des « bandits » sans fournir aucune preuve, en partie afin d’augmenter la pression populaire sur les contingents retranchés dans leur base sise près de l’aéroport de Niamey et dont elle était pressée d’être débarrassée. Lors d’un petit discours télévisé – au cours duquel personne n’a été autorisé à poser des questions ou réclamer des preuves – le premier ministre de la junte du Niger a accusé la France d’avoir organisé une attaque terroriste près du barrage en construction à Kandadji, en vue de « déstabiliser » le Niger, comme l’aurait publiquement annoncé « un Français » dont il a tu le nom (Il faisait apparemment référence à une analyse entendue sur la chaîne LCI). Celle du Burkina a accusé les Français installés au Niger d’avoir approvisionné « les terroristes », avec un luxe de détail dont le journal Faso Times s’est fait l’écho : « Selon des informations reçues de source fiable, le service de renseignement burkinabè détient les preuves que le stock de carburant, d’armes, de munitions, de logistique de combats progressivement rassembler [sic] pendant 2 jours au nord-est à 8km de Djibo ont [sic] été entièrement fournis par des unités de l’armée française stationnées à la frontière Niger-Burkina précisément à Tillabéry. Les éléments de l’unité française sont actifs dans la zone frontalière comprise entre Ayourou [sic], Darkindé, Day Kayna et ils infiltrent le Burkina à partir de Tangoudja, Tampatiga et Djandjergou. » Cela continue sur plusieurs paragraphes. (Une fois ces biens saisis et détruits par les milices VDP, il s’est avéré qu’il s’agissait de marchandises importées par des négociants burkinabés).
Les chefs militaires se sont souvent alliés, une fois au pouvoir, à des politiciens prêts à faire feu de tout bois afin de faire avancer un certain agenda. Au Niger, il s’est surtout agi de politiciens locaux et leaders d’opinion de l’ouest du pays, plus connectés aux évolutions du Mali et du Burkina Faso et férocement opposés au pouvoir du président renversé Mohammed Bazoum. Au Mali, le premier ministre, dont la carrière pour le moins sinueuse est bien connue, est néanmoins possédé d’une ambition qui le fait viser droit au but, celle d’imposer la révision ou d’empêcher l’application des accords d’Alger, ambition qui trouve des échos dans le sentiment patriotique malien et dans la conception qu’ont certains des chefs militaires de l’honneur de l’armée : ces accords n’ont été imposés au Mali que du fait de la faiblesse de l’armée face aux rebelles de l’« Azawad », qui, par ailleurs, auraient été soutenus par les Français (cette accusation, pour une fois, n’est pas dépourvue de plausibilité). Quant au premier ministre burkinabè, qu’on peut entendre, dans une archive télévisée, chanter les louanges dithyrambiques de la France, et qui a longtemps été un critique du poste de… premier ministre, son ascension audit poste combine l’opportunisme politicien et l’engagement idéologique, puisqu’il est présenté comme un chef de file des sankaristes.
Il n’est pas certain que les militaires au pouvoir soient eux-mêmes des néonationalistes. Si Kyélem de Tambéla du Burkina l’est sans doute du fait de ses affinités sankaristes (Sankara lui-même n’était pas un néonationaliste, de même que le Christ n’était pas chrétien), Choguel Maïga du Mali n’en est certainement pas un. Mais ils ont tous accepté le soutien des néonationalistes, qui ont l’oreille des masses pour tout ce qui touche à la question sécuritaire – question qui, ne l’oublions pas, a été le principal canal de leur arrivée au pouvoir. Et le point de ralliement entre les militaires, les politiciens sur le retour et les néonationalistes est l’idée fixe de la France comme ennemie jurée du Sahel.
Étant donné l’utilité stratégique de cette idée, la France occupera ce rôle préjudiciable tant que la situation politique n’aura pas évolué dans une direction entièrement différente de ce qu’elle est en ce moment. Son éviction, et les relations diplomatiques glaciales qui en ont découlé, n’impliquent pas, du point de vue néonationaliste, que l’indépendance serait enfin acquise : l’admettre serait suicidaire, puisque cela reviendrait à dire que la lutte néonationaliste, déterminée entièrement par le rapport à la France, n’a plus de raison d’être. Dans cette « lutte », de nouveaux chantiers peuvent être envisagés de façon pratiquement infinie. On peut alors supposer que le néonationalisme ne survivra pas, en tant que force agissante, à ses usages politiques. Mais ceux-ci peuvent évoluer et donc durer. Les juntes au pouvoir dans les trois pays, bien que présidant, officiellement, à des « transitions », se sont données des mandats plus expansifs de « refondation ». Ces mandats supposent la mise en place d’un régime d’exception (même si cette formule est soigneusement évitée), non un appareil participatif à chronogramme, comme celui qui organise une transition ; et une action en profondeur sur la société, laquelle, suivant les données observables, vise moins à la réformer qu’à établir des structures de contrôle permettant ensuite d’agir librement, sans freins et contrepoids ni souci excessif de la presse ou de la société civile. Le discours néonationaliste, en produisant des catégories d’ennemis comme les traîtres, les antinationaux ou les antipatriotes (souvent présentés comme des complices de la France), impose, dans la sphère publique qu’il a saturée et donc virtuellement verrouillée, les projets des juntes. Dans ce contexte, seule la fin de ces régimes peut libérer le Sahel de son emprise – ce qui ne semble pas être pour demain.
R I

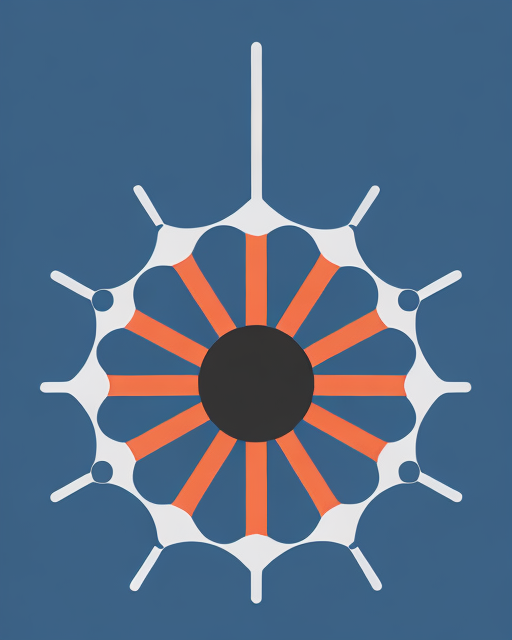
 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur Twitter
Partager sur Twitter Imprimer cet article
Imprimer cet article