Le parc est calme le premier jour du confinement national.
La peur du nouveau coronavirus déferle sur le monde, les hôpitaux sont submergés, les patients meurent dans leurs couloirs, les cimetières ne peuvent faire face au déluge de morts, les gouvernements mettent à l’arrêt toutes les activités.
En Afrique du Sud, le Président s’est adressé à la population. Un confinement national, annonce-t-il, allait commencer. Les gens allaient devoir rester enfermés chez eux. La plupart des secteurs de l’économie allaient entrer en hibernation. En dehors des alimentations, les boutiques baisseront rideau, les restaurants, les tavernes et les bars fermeront. Il sera interdit à la population de se déplacer, sauf pour se procurer de la nourriture et d’autres produits de première nécessité ; cigarettes et alcool ne seront plus en vente ; un couvre-feu entrera en vigueur. L’armée appuiera la police le cas échéant. Les parcs, les gyms et les lieux de villégiature suspendront leur activité. C’était l’un des plans de confinement les plus drastiques du monde, lancé à un stade plus précoce de la propagation de la pandémie que dans n’importe quel autre pays. Cela signifie-t-il que nous sommes l’un des meilleurs pays du monde ?
Installé à mon bureau, je n’ai qu’à tourner la tête pour me distraire avec le spectacles des choses qui se passent dans le parc. Le parc, notre parc, nous dira peut-être, pendant cette période, si nous sommes le meilleur pays du monde – oui, ce vert rectangle d’herbe mal tondue qui descend en pente douce depuis la ligne de bouleaux argentés plantés contre un mur de béton à l’ouest, là où un espace ondulant est parsemé d’équipements de jeu installés au milieu de quelques arbres, jusqu’au terrain de football et au groupe d’équipements de gymnastique à l’est, à côté d’un autre mur de béton sur lequel une peinture faite avec art montre des gens qui profitent de leurs loisirs.
Par exemple, j’entends une détonation, je lève les yeux et je vois des gens se disperser. S’agit-il d’un pétard, comme c’est souvent le cas vers la fin de l’année ? Est-ce un coup de feu ponctuant une dispute, chose peu fréquente ces temps-ci ? S’agit-il d’une troupe d’agents en surpoids qui tirent des balles en caoutchouc avec leurs carabines afin de chasser les citoyens de notre république du terrain de football et de l’herbe verte et vider le parc de leur présence désormais illégale ?
Chaque incident a quelque chose d’énigmatique.
Notre parc est plutôt petit, de la taille d’un pâté de maisons, un îlot de verdure dans une banlieue intérieure pour le moins décrépite où les gens viennent jouer avec leurs enfants, se prélasser sur l’herbe, s’époumoner joyeusement sur le toboggan ou les balançoires, fumer du zol ou vendre de la drogue, dormir au soleil quand ils n’ont pas de travail, pas d’argent et nulle part où aller, ou encore jouer au foot. Parfois, il y a quelqu’un qui prêche. J’habite juste en face du parc. J’ai vu cet espace changer lentement depuis la fin de l’apartheid il y a trente ans, la banlieue blanche devenant une banlieue mixte, puis une banlieue noire. Et maintenant : pandémie, confinement.
8h30, début du confinement. Quelques policiers juchés sur d’énormes motos traversent le parc – il m’avait paru vide, mais voilà qu’une poignée de personnes se dispersent et détalent, et les jeunes hommes de l’immeuble voisin se précipitent à l’intérieur du bâtiment en rigolant. À présent, ils se sont mis à l’extérieur, devant l’immeuble, mais à l’abri derrière sa clôture, et ils écoutent de la musique. Il n’y a personne sur le terrain de foot. De temps en temps, quelqu’un traverse le parc, parfois un petit groupe. Bien qu’ils soient en petit nombre, il n’y nul signe de distanciation physique – trois hommes marchent très près les uns des autres, deux jeunes filles vont côte à côte.
11h30 : les jeunes hommes d’à côté ont sorti un canapé et boivent de la bière. Des sirènes de police retentissent en direction de Rockey Street, la célèbre rue de divertissement et de shopping qui traverse notre banlieue en la coupant en deux.
15 heures : de plus en plus de gens se prélassent dans le parc. Quelques jeunes femmes ont rejoint les hommes d’à côté. Les gens testent les limites de ce qu’ils peuvent faire, ils reviennent lentement, par précautionneuses étapes, à des schémas normaux pour voir s’il y a une réponse de l’État…
D’autres sirènes proviennent d’une autre partie de Yéoville. Un peu plus tard, d’autres sirènes encore, puis trois véhicules de police apparaissent et descendent lentement la rue de l’autre côté du parc. Certaines des rares personnes qui s’y trouvent prennent la fuite, d’autres se contentent de regarder. La police est également en train de tester la situation.
Le lendemain, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit un convoi de véhicules de police descendre une rue à quelques pâtés de maisons du parc, des coups de feu retentissent, des gens courent, puis l’écran bascule dans une confusion de sons indistincts. On entend ensuite la voix d’une femme qui crie d’une voix angoissée : Arrêtez de tirer ! Arrêtez de tirer ! Je suis journaliste ! L’écran s’éteint. Le président du Community Policing Forum déclare qu’il s’agit d’une fausse information. Le commissaire du quartier dit qu’il ne s’est rien passé à Yéoville. Plus tard dans la journée, la journaliste confirme que la vidéo n’avait rien de truqué.
En dépit de la nouvelle clôture installée il y a deux ans par la municipalité, en même temps que le nouveau terrain de foot à sept, la salle de sport en plein air, les balançoires et le toboggan, notre parc ne peut pas être fermé. Certains panneaux de la clôture avaient rapidement disparu, bientôt suivis des barrières. Ces brèches n’empêchent cependant pas que le parc soit devenu un désert, à l’exception des silhouettes de ceux qui s’en servent comme raccourci pour se rendre au supermarché, et d’une poignée de sans-abri. Au bout de deux semaines, cependant, des jeunes commencent à y apparaître, excédés d’être cloîtrés dans des appartements et des chambres bondés, et lassés par le manque d’activité.
Voilà que les jeunes hommes d’à côté organisent une petite fête dans le garage situé en dessous des appartements. Bientôt, plusieurs jeunes hommes se mettent à garer régulièrement leur voiture à l’extérieur, on lave les autos, on papote, on écoute de la musique. Personne ne porte de masque. La vie collective réapparaît. Et les matchs de foot reprennent. Puis les flics arrivent, armés de fusils de chasse et de balles en caoutchouc.
Je m’en aperçois d’abord en voyant des vagues de jeunes qui s’éparpillent à travers le parc, courant à toutes jambes pour en sortir et s’évanouir dans la nature. Qu’est-ce qui a pu provoquer cette panique ? Puis j’entends un bang-bang, je vois les flics, les petites bouffées de fumée de leurs fusils de chasse. Une camionnette se faufile dans les allées et deux ou trois flics en bondissent pour poursuivre les jeunes fuyards, sans le moindre espoir de les rattraper. Le lendemain, un convoi entier de camionnettes, de voitures, de pick-up aux vitres teintées et d’un ou deux fourgons militaires apparaît, descendant à toute allure d’un côté du parc tandis que d’autres remontent le côté opposé, s’arrêtent dans des hurlements de pneu et les flics chargent de tous les côtés, nettoyant le parc et arrêtant les quelques personnes qui ne peuvent pas s’enfuir
Depuis lors, des véhicules de police passent plusieurs fois par jour. Les personnes rassemblées à côté sont sommées de se disperser, et les jeunes hommes sautent dans leur bagnole pour filer. Les sans-abri qui venaient régulièrement chez nous le samedi matin pour prendre une boîte de conserve et échanger des nouvelles ont cessé de se présenter à notre porte, et un soir, à la nuit tombée, Dudley et Arnold, deux de nos habitués, vinrent nous expliquer qu’il était dangereux de circuler dans les rues pendant la journée, car la police rassemble les sans-abri et les emmène dans des camps désignés, les coupant ainsi des précieux réseaux de survie dont ils dépendent.
Le temps passant, l’intensité de la présence policière diminue. Dans le parc, les affrontements se transforment en un jeu du chat et de la souris, car les gens se rendent compte de l’inaptitude physique et de la lenteur des policiers, ainsi que de la portée limitée des balles en caoutchouc, et se mettent à rire et à se moquer d’eux une fois qu’ils ont atteint une distance de sécurité. Pendant que cette petite guerre du parc se déroule dans leur dos, les passants vaquent à leurs courses dans la rue sans se presser. Les convois de démonstration de force se raréfient puis s’arrêtent, la police trouvant apparemment mieux à faire ailleurs. Les joueurs de foot reprogramment leurs matchs à l’aube, ce qui correspond également à la période de changement d’équipe au poste de police, de sorte qu’il y a peu d’activité policière. Les cris des joueurs et les hurlements des foules de supporters se mettent à retentir dans les fraîches matinées d’automne.
L’étalage de la puissance de la loi devient plus épisodique. Désormais, une camionnette de police passe au hasard devant le parc avec trois ou quatre agents, masqués contre le virus, leurs carabines dépassant des fenêtres comme s’ils étaient des chasseurs en safari, et s’ils voient une activité qui les dérange, ils s’arrêtent et ouvrent le feu par les fenêtres, sans prendre la peine de descendre de voiture et se lancer à la poursuite des contrevenants. La loi et l’ordre ainsi rétablis, ils s’en vont, satisfaits.
Et ainsi une nouvelle énigme surgit. Qu’est-ce qui explique la facilité avec laquelle les citoyens peuvent se faire tirer dessus dans notre démocratie ? Mais peut-être que ce n’est pas du tout une énigme ?
Lizzie Khubeka, qui fait le ménage chez nous et vit dans une chambre d’appartement sur la colline, n’est certainement pas déconcertée par ce fait. Ces garçons sont des vauriens, nous dit-elle. Notre voisin, M. Matlala, ancien délégué syndical, abonde dans le même sens. Selon lui, ces jeunes garçons doivent être disciplinés. Le président du Community Policing Forum nous dit qu’il faut appliquer la réglementation sur les pandémies et qu’il y a beaucoup de vente de drogue dans le parc. De toute façon, dit-il, la police utilise des balles à blanc – bien que les douilles que nous ramassons dans le parc suggèrent le contraire. Quant aux deux jeunes hommes qui vivent avec leur mère dans l’un des appartements d’à côté et qui font partie des joueurs de foot, ils se contentent de rire et de nous apporter les douilles.
Il semble que nous sommes les seuls à être perplexes.
Non pas que cette façon sévère qu’a la police d’appliquer la loi ait été en évidence seulement durant la pandémie. Cela est loin d’être le cas.
*
Après six semaines d’un confinement draconien, le Président annonce un léger assouplissement du niveau 5 au niveau 4. Entre autres, l’exercice physique dans les lieux publics est désormais autorisé entre 6 et 9 heures du matin. Les rues des banlieues se remplissent de joggeurs dès l’aube.

Du jour au lendemain, notre parc devient un carnaval d’humanité. Des femmes, des hommes, des enfants de toutes tailles et formes s’y livrent à l’exercice – au jogging, à la boxe, à la muscu. Nous sortons et nous joignons à eux, marchant d’un bon pas autour de la piste de jogging. Des jeunes en tenue de sport nous dépassent, une femme âgée d’amples dimensions avance à pas lents avec beaucoup de concentration, un père apprend à deux enfants à faire du vélo. Au fil des semaines, nous constatons leurs progrès. Il y a trois grands groupes de femmes, chacun avec un instructeur masculin qui les guide dans leurs exercices. Les instructeurs semblent être des Nigérians. Beaucoup ici sont manifestement des adeptes de sport, costauds, en forme, habillés pour un effort physique maximal, faisant des abdominaux ou des pompes, bondissant, effectuant de nombreux tours à la course. Quatre boxeurs pirouettent et tapent, dansant d’avant en arrière en un hypnotique spectacle, leur combat chorégraphié de manière à prendre chaque coup sur le gant. D’autres sont novices, en surpoids, raides, vêtus de vieux survêtements et de maillots. Tous savourent l’effort dans l’air vivifiant.
En faisant le tour de la piste, nous passons de la froidure intense de l’ombre à la chaude morsure du soleil, puis de nouveau à l’ombre. Près de l’entrée en coin la plus éloignée, nous passons devant un groupe d’hommes qui ne sont pas le moins du monde intéressés par l’exercice. Ils confèrent, l’air est chargé de l’odeur douce et rêche du zol, ils vendent du chocolat dans une boîte, et très probablement aussi de la drogue. Nous passons devant les jeunes hommes en nage qui s’évertuent sur les appareils de gymnastique. Nous passons devant le match de foot âpre et déterminé, les membres des joueurs luisent au soleil, et des rangées de footballeurs s’exercent sous les yeux de leurs entraîneurs. Nous passons dans l’ombrage, sous les arbres d’un autre côté du parc. Nous passons devant les sans-abri qui campent à l’extrémité supérieure du parc. Ils ne sont pas impressionnés par l’irruption soudaine de foules de sportifs bruyants dans ce qui est de fait leur chambre à coucher. Certains tournent le dos et s’enfoncent dans leur literie, tandis que d’autres s’enroulent de leurs couvertures et contemplent impassiblement le transitoire défilé matinal, attendant que tout ce beau monde s’en aille à 9 heures pour pouvoir sortir et faire leurs ablutions au robinet. Nous retraversons la rue et rentrons à la maison pour le café et le petit déj.
Un tel spectacle n’a jamais été vu dans le parc. Les gens oui – surtout après l’installation de la nouvelle clôture et le travail de rénovation. Les familles et les groupes d’enfants et d’amis se réunissaient ici pour se détendre, jouer et rire le week-end, et il y avait beaucoup d’activité, mais toujours en contrepoint du repos et du plaisir de paresser, jamais de façon aussi concentrée et déterminée. C’est comme si soudain « la population » et « l’espace public » s’étaient rejoints, s’épanouissant à la lumière du soleil en une glorieuse expression de vie communautaire retrouvée, après six semaines d’isolement, d’anxiété, d’ennui et de peur. Nous avions commencé à oublier ce que c’était que d’être parmi les gens. Nous ressentons également notre propre bizarrerie – un couple blanc d’âge mûr, dont l’un est en fauteuil roulant, qui vadrouille dans un espace exclusivement noir. Il ne s’agit évidemment pas d’une « population » abstraite ou d’une « société » en général, mais de l’Afrique du Sud, ici et maintenant. De temps à autre, un regard s’attarde sur nous lorsque nous passons, s’interrogeant sur notre présence. D’autres nous saluent joyeusement.
Malheureusement, ce moment ne devait pas durer. Dès la levée des restrictions, quelques semaines plus tard, lorsque l’exercice dans les lieux publics fut de nouveau autorisé à toute heure du jour et que de nombreux secteurs de l’économie furent rouverts, il passa. Nombre de ceux qui faisaient du sport en début de journée doivent maintenant aller au travail ou préparer leurs enfants pour l’école. Les séances d’entraînement continuent, mais avec moins de participants et sans heure fixe. Il semble que nous ayons perdu quelque chose – une certaine forme de camaraderie, un sens partagé de notre détresse commune.
Au cours de la même période, le rassemblement du côté de nos jeunes voisins prend de l’ampleur, et franchit la route pour atteindre la clôture du parc. L’alcool est toujours interdit. Chaque après-midi, le groupe de jeunes hommes se réunit au soleil, et bavarde, ils sont parfois une douzaine, parfois une vingtaine, leurs voix s’élevant et devenant de plus en plus querelleuses au fur et à mesure que les ombres s’allongent. De temps en temps, une femme arrive au bras d’un homme. Parfois, un couple à l’allure plutôt rupine descend d’un coupé sport. Ils boivent, mais discrètement. La plupart d’entre eux arrivent en voiture. Les deux frères du voisinage brassent de la bière dans leur garage et approvisionnent l’assemblée, discrètement. Vers le coucher du soleil, ils se dispersent. Le couvre-feu est toujours en vigueur.
Si les incursions occasionnelles de policiers armés dans le parc ne cessent pas, la police entretient des relations de plus en plus amicales avec nos voisins. À certaines heures de la journée, on peut apercevoir un véhicule de police arrêté devant l’immeuble, ses occupants causant et riant avec les deux frères. Après quelques semaines, ils font de même avec d’autres membres de l’assemblée. Nous apprenons que les deux jeunes hommes, nos voisins, sont impliqués dans une arnaque à la vente de voitures. Ils photographient une voiture coûteuse, n’importe laquelle, et en font la publicité sur les réseaux sociaux. Lorsqu’ils reçoivent des appels, ils demandent aux personnes intéressées d’envoyer de l’argent pour le carburant afin qu’ils puissent leur amener la voiture pour un examen et un tour d’essai. Ensuite, ils touchent l’argent envoyé, jettent la carte SIM et recommencent.
Avec le temps et l’assouplissement progressif des conditions du confinement, le rassemblement change. Tout d’abord, il s’éloigne des appartements, qui se trouvent juste en haut de la rue à partir de chez nous, pour prendre place au niveau d’un petit socle en béton, sous un arbre, sur le trottoir, juste en bas de la rue par rapport à notre domicile. Les deux jeunes hommes de l’appartement semblent de moins en moins désireux d’être impliqués, et les participants arrivent avec leur propre alcool. Certains membres du noyau dur arrivent en milieu de matinée, bavardent et plaisantent. En fin de matinée, quelqu’un arrive avec des plats à emporter qui sont distribués. Parfois, l’un des vendeurs de fruits qui sillonnent les rues avec leurs chariots remplis de fruits passe par là, et les hommes rassemblés achètent et partagent des papayes ou des ananas. De plus en plus de personnes arrivent au cours de l’après-midi, et bientôt une fête est en cours.
Le Président annonce une plus grande ouverture des secteurs économiques et une relaxation de la réglementation. L’alcool et les cigarettes restent interdits. Ces discours du Président – il s’adresse à la nation au sujet de la grave crise à laquelle nous sommes confrontés. Il parle du virus, des règles à observer et du comportement nouveau que nous devons cultiver, de l’économie, de ses discussions avec les ministres et les entreprises, de tout ce que le gouvernement fait pour nous protéger de la crise sanitaire et de la crise économique. Il est sérieux, sobre et inquiet. Mais l’Afrique du Sud à qui il parle n’existe pas dans notre parc et notre quartier. Application de la loi par la police ? Masquage et distanciation physique ? Pas d’alcool ? Distribution de colis alimentaires et d’aides d’urgence ?
Aucune personne que je connais ou dont j’ai entendu parler dans ce quartier n’a reçu de colis alimentaire ou de subvention, bien que certains aient essayé. Certaines personnes se masquent et font attention, mais beaucoup ne le font pas. Mais c’est peut-être un constat injuste. Par définition, ceux qui prennent les règles au sérieux sont beaucoup moins visibles dans le parc ou dans la rue. Ils ont tendance à rester chez eux, à éviter les foules, à se rendre au travail masqués. Ceux que nous voyons sont ceux qui ne prennent pas, ou ne peuvent pas prendre les règles au sérieux.
*
Au temps du confinement rigoureux, nous vivons complètement isolés et nous nous montrons très prudents lorsque nous sortons pour faire des achats de première nécessité. Lors du premier assouplissement, lorsque le parc a pris des airs de gymnase en plein air, j’ai une conversation téléphonique avec mon voisin, ami et collègue de longue date, M. Matlala. Il me dit qu’il se réveille la nuit, inquiet, parce que son cœur fait des bonds et qu’il n’arrive pas à respirer. Il est allé voir son médecin qui lui a dit qu’il n’y avait rien de grave, mais lui a donné des pilules. Comme cela ne l’a pas aidé, il est allé voir le guérisseur traditionnel qui lui a également dit qu’il n’y avait rien d’anormal. Il craint de mourir seul dans son lit, sans personne pour l’aider. Sa femme est décédée il y a trois ans et il évite ses enfants et leurs familles, qui partagent sa demeure, parce qu’il doute qu’ils soient assez prudents. Il ne fait que travailler sur son ordinateur, dîner seul et regarder la télévision. Le seul moyen d’éviter le coronavirus est de s’isoler complètement, et il vit dans la crainte de cette menace invisible.
Nous évoquons le concept de crise de panique. Oui, il a entendu parler de cela mais ne sait pas de quoi il s’agit. Je lui raconte comment nous vivons de notre côté, sans trop travailler, en passant du temps dans le jardin et en ayant de longues conversations. Bien sûr, nous sommes mariés et nous nous tenons compagnie l’un à l’autre. Le lendemain matin, il me téléphone en riant. J’avais été de bon conseil, dit-il, il a bien dormi et a continué à rire tout seul au milieu de la nuit en pensant que son voisin l’avait sauvé.
Nous convenons de prendre une tasse de thé ensemble dans le jardin le week-end, et Adèle prépare un gâteau. Quelques jours plus tard, il est dans le parc et photographie la communauté lors de ses exercices. À partir de ce moment-là, nous nous retrouvons de temps en temps pour prendre le thé dans le jardin et, lorsque la pandémie a reculé, nous organisons le premier braai, dans le jardin, ensemble mais à bonne distance les uns des autres. Le feu, la fumée, les arômes de viande grésillante sont des plaisirs merveilleusement sensuels et sociaux qui nous ont manqué pendant des mois et des mois.
Quelque temps plus tard, alors que l’hiver s’est transformé en été, notre amie Pumza et son fils adolescent nous rendent visite pour un autre de nos thés dans le jardin. Nous les voyions régulièrement depuis des années, ils vivent dans l’un des appartements à côté du parc, mais nous ne les avons pas vus depuis des mois. Comme il est étrange de les revoir en chair et en os, malgré nos voix qui restent étouffées par nos masques, jusqu’à ce qu’arrivent les scones frais et le thé, et que les masques tombent. Ce sont les petites victoires par lesquelles nous célébrons nos retrouvailles avec la vie en société.
Pumza et Khwezi s’étaient eux aussi mis en confinement total. Elle a un emploi dans la fonction publique, et son service a adopté le travail à distance. Khwezi dit qu’il a apprécié de faire la grasse matinée chaque jour jusqu’à ce que son école réouvre sur la base d’un système de rotation. Pholo (3 ans) est tout simplement ravie d’avoir son grand frère pour elle seule tous les jours. Pumza a pris l’habitude de courir tôt le matin pour rester en forme et évite d’aller au parc pour faire de l’exercice, car elle pense qu’il y a trop de monde. Elle dit avoir découvert qu’elle n’est pas la personne sociable qu’elle pensait être, elle est à peine restée en contact avec ses amis et les sorties avec eux ne lui ont pas du tout manqué. Adèle dit qu’elle a eu exactement la même réaction et qu’elle s’est trouvée heureuse de laisser tomber ses engagements sociaux, alors que moi, au contraire, je suis étonné et détaille à quel point le contact avec les amis me manque, et comment j’ai terriblement envie de sortir à nouveau.
*
Ce matin, lorsque nous nous réveillons, que la matinée commence et que nous ouvrons les rideaux, il y a un corps dans le parc. Nous sommes à la mi-août, un matin de semaine ordinaire. Une voisine me dit qu’elle s’est réveillée dans la nuit et qu’elle a vu les lumières bleues des voitures de police et des silhouettes dans le parc à travers la fenêtre de sa salle de bain, et qu’elle s’est demandé ce qui se passait. Nous discutons de savoir s’il faut sortir et regarder. Est-ce intrusif, voyeuriste ? N’est-il pas important de porter témoignage ? Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous sortons.
Un fourgon de police se trouve dans le parc et veille sur le corps à une certaine distance. Les deux officiers, masqués, s’ennuient et jouent avec leur téléphone portable. Ils ne savent pas ce qui a pu se passer. Monosyllabiques. Réticents. Comme si ce n’était pas à eux de répondre aux questions, ni à nous de les poser.
Il y a un petit groupe coi de personnes dans l’allée, qui regardent le mort. Les nouveaux arrivants demandent : qui est-ce, que s’est-il passé ? L’homme est couché sur le côté, la joue contre l’herbe, échevelé. Son pantalon et ses autres vêtements sont éparpillés dans l’herbe derrière lui, et il est nu à partir de la taille, son caleçon tiré jusqu’aux genoux. Sa fin a été violente. À cette époque de l’année, l’herbe est sèche, jaune et morte, et des brins s’accrochent à son maillot et à son visage, et une nuée de mouches tournoie autour de sa tête qui, de l’endroit où nous sommes, a l’air meurtrie. Il gît là, dans le soleil naissant, un corps, inapaisé, inconnu, il est là depuis déjà trop longtemps, ses derniers instants exposés aux yeux de tous, et pourtant impénétrables. Il y a quelque chose d’indistinct en lui, comme s’il se dissolvait un peu sur les bords. On ne connaît pas son nom, ni sa famille, ni s’il en avait une. Il y a une petite flaque boueuse dans l’herbe devant son visage.
Les visages des gens, nos visages, troublés, tentent de percer l’obscurité de cette mort et de la vie qui a été arrachée ici. Les gens autour murmurent qu’il n’est pas normal qu’il soit ainsi couché sans rien pour couvrir sa nudité. Pourquoi la police n’a-t-elle pas fait ce qu’il fallait ? Adèle va demander aux agents si elle peut aller chercher un drap pour le couvrir. Ils acceptent. Elle rentre à la maison et revient sur l’herbe avec un drap, et l’une des femmes parmi les autres spectateurs s’avance et l’aide à l’étendre sur lui. Même l’un des policiers s’anime, sort de la camionnette, observe et lève le pouce en signe d’appréciation. C’est mieux, il y a une certaine dignité dans cette pudeur, une certaine reconnaissance que c’est une personne qui est morte ici la nuit dernière.
*
Plus tard dans la journée, les hommes se réunissent comme d’habitude à l’orée du parc. Il n’y a aucune trace du décès dans le parc. Le fourgon mortuaire a emporté le corps en milieu de matinée.
À présent, nous commençons à nous sentir quelque peu assiégés. Des voitures se garent souvent en travers de notre allée. Certains soirs, de la musique forte est diffusée par les amplis de l’une des automobiles. Lorsque nous nous plaignons auprès de personnes que nous avons fini par identifier comment étant des membres principaux du groupe, ils demandent immédiatement au contrevenant de baisser le volume de la musique et de déplacer la voiture.
Nous pouvons vous aider à tout moment, disent-ils. Si vous avez besoin d’un boy de jardin, dites-le-nous et nous le trouverons. Même si vous avez besoin d’une fille pour faire le ménage. Nous leur reprochons leur vocabulaire colonial, mais nous sommes des Blancs.
Il semble qu’il se passe de multiples échanges et transactions. Des marchandises qui remplissent le coffre d’une voiture sont transportées d’une petite voiture grise à un gros « bakkie » noir. Un autre jour, c’est des liqueurs. Une autre voiture arrive, quelqu’un se détache de l’attroupement et parle au conducteur ou au passager, il lui remet quelque chose – probablement de l’argent liquide – et quelques instants plus tard, il revient et remet un petit paquet – probablement de la drogue. À plusieurs reprises, de grosses sommes d’argent ont été aperçues sur les genoux d’une personne assise dans l’une des voitures. Tous les jours, des véhicules de police passent, trois en particulier, et s’arrêtent au bord de la route. Quelqu’un s’approche, il y a une conversation et quelque chose s’échange. Parfois, l’un des véhicules de police se contente simplement de passer avec un hululement amical ou même un bref coup de sirène et un salut de la main. Tout cela au vu et au su de tous.
Trois ou quatre fois, les flics se dirigent en roulant des mécaniques vers l’une des voitures garées, ordonnent aux occupants de sortir et commencent à les fouiller, puis à fouiller la voiture. De mon point de vue, il semble qu’ils ont trouvé des objets intéressants ou suspects sur les hommes, dans le coffre ou sous un siège. Ils ordonnent aux hommes de monter dans la camionnette. L’arrestation semble imminente. Mais ensuite, les hommes sont autorisés à remonter dans la voiture, une conversation s’engage, et les policiers regagnent leur camionnette et repartent. S’agit-il de fouilles sérieuses, sans résultat ? Une façon d’extorquer plus d’argent ? Ou s’agit-il d’un spectacle public, démontrant à tous ceux qui regardent que la police fait son travail ?
Là encore, le parc présente une énigme. La police a l’air d’être aux commandes, mais l’est-elle vraiment ? D’un certain point de vue, on voit des hommes redoutables qui manient la loi, qui décident qui poursuivre, qui ne pas poursuivre, qui décident quand appliquer la loi et quand l’assouplir, et si cet assouplissement peut être marchandé. Si vous changez légèrement d’angle, vous verrez des hommes redoutables dans le parc, polis, avenants, conviviaux mais dotés du pouvoir d’acheter la loi et de la plier à leurs desseins. Sous cet angle, c’est la police qui apparaît faible, neutralisée face aux patrons de réseaux puissants et lucratifs, capables d’établir leur propre système d’ordre et d’y coopter la police.
À travers nos réseaux, nous contactons un haut responsable du renseignement criminel, et un colonel vient nous rendre visite. Il nous explique qu’il s’agit là du mode opératoire des trafiquants de drogue : ils se réunissent régulièrement dans un lieu anodin tout en construisant leurs réseaux et leurs alliances et en concluant des marchés, et ils veillent à cultiver des relations amicales avec la communauté qui les entoure. Ils sont délibérément polis, amicaux et bien habillés. Toute personne qui crée des problèmes sera mise au pas. Il dit qu’il pourrait envoyer une équipe pour les perquisitionner, mais qu’il ne trouverait rien et qu’il préfèrerait recueillir des renseignements sur eux. Il reviendra certainement pour passer quelques heures à les étudier depuis une pièce au deuxième étage de notre maison, et à prendre des photos, afin que lui et ses collègues puissent essayer d’établir des liens entre ce groupe et d’autres sur lesquels ils enquêtent. Sommes-nous d’accord ? Bien sûr que nous le sommes. Toutes autres choses mises à part, cela nous permettrait de résoudre l’énigme de la raison d’être précise de ce rassemblement. Il a ajouté qu’il aura une apparence différente lors de sa prochaine visite, qu’il sera probablement vêtu en bleu de travail et se présentera comme une sorte d’entrepreneur.
Nous ne le revîmes plus jamais, mais nous eûmes de ses nouvelles à plusieurs reprises. Pour être honnête, les services de renseignements criminels ont leurs propres problèmes à régler. Un colonel enquêtant sur les gangs, le crime organisé et les flics corrompus du Cap-Occidental est assassiné. Le beau-frère d’un administrateur d’université, également membre des services de renseignements criminels, est abattu. Le chef des renseignements criminels, l’un de ceux qui cherchent à assainir les forces de police et qui a enquêté et poursuivi plusieurs policiers corrompus, est suspendu en raison de soupçons de corruption. Si vous savez lire correctement les choses, vous comprenez que cette accusation fait partie de la riposte des corrompus. Les choses ne sont jamais ce qu’elles semblent être.
Avec l’arrivée de l’été, le rassemblement se déplace dans le parc en quête d’ombre. Cela améliore la situation, bien qu’il y ait toujours un va-et-vient constant de voitures, le bruit d’hommes aimant le tapage et un tas de boîtes de repas à emporter en polystyrène éparpillées sur l’herbe dans la zone qu’ils occupent. Les enfants et les familles évitent cet espace. Les flics passent encore trois ou quatre fois par jour, ils klaxonnent ou font retentir leur sirène, quelqu’un se précipite et l’échange habituel a lieu.
Au début du mois de décembre, vient un jour où un étrange silence s’abat sur notre rue et sur le parc. Il n’y avait eu aucun jour sans rassemblement depuis avant le milieu de l’année. Nous plaisantons en disant qu’ils sont peut-être partis faire du team-building ou une excursion à la campagne. Le lendemain, c’est la même chose. Le week-end arrive et s’en va. Ils ne réapparaissent pas.
Le président du CPF affirme que la police provinciale est venue avertir les hommes attroupés que le parc n’était pas adapté à leur type de rassemblement et qu’ils devaient partir. Bien entendu, il n’y a aucune tentative de recherche ou d’enquête sur les policiers qui ont reçu des pots-de-vin tous les jours pendant six mois. Puis nous découvrons que le rassemblement s’est effectivement déplacé – dans une habitation située à un pâté de maisons, avec toutes les habituelles voitures garées dans la rue à l’extérieur. Il ne fait aucun doute que les mêmes camionnettes de flics passent tous les jours pour un petit coucou amical. Mais nous avons au moins retrouvé un calme relatif, avec seulement les bruits habituels des jeux d’enfants, des compétitions de foot et les conversations murmurantes des amoureux ou des parents et des enfants sur les bancs en béton du parc.
*
Alors, l’Afrique du Sud n’est-elle pas le meilleur pays du monde ?
Au cours de l’année écoulée, notre parc a révélé des énigmes liées à la loi, des énigmes liées à l’ordre public. Il a révélé le carnaval de la vie dans notre quartier et sa terrifiante capacité à infliger la mort violente. L’image de l’homme, de son corps inapaisé, reste imprimée dans le parc sous la forme d’une question qui ne trouve pas de réponse. Nous ne connaissons toujours pas son nom, alors même que les premières pluies d’été emportent la poussière, et l’herbe verte du printemps remplace l’herbe morte de l’hiver. La police indique qu’elle n’a pas connaissance d’un décès. Un prédicateur installe un système de sonorisation avec l’aide de ses acolytes et, quatre après-midis de suite, il met en garde contre le péché et les pécheurs, l’enfer et la damnation en des tirades si bruyamment retransmises par les amplis que personne parmi nous ne peut échapper à ses visions.
Il y a maintenant une deuxième vague de la pandémie et de nouvelles restrictions, annoncées par le président. Il semble accablé et au bord des larmes. Peut-être est-ce le poids de tous ces parcs en Afrique du Sud, de toutes les personnes qui s’y trouvent et de toutes les énigmes qu’ils renferment.
Il annonce que tous les parcs sont fermés. Mais dans le nôtre, rien ne change, il est plein d’éclats de voix, de soleil et de cris de joie, et lorsque les fourgons de police passent, ils ne montrent absolument aucune intention de le vider.
Sociologue à l’université du Witwatersrand et conteur, Karl von Holdt a vécu à Johannesburg de nombreuses années et s’est récemment installé au Cap.

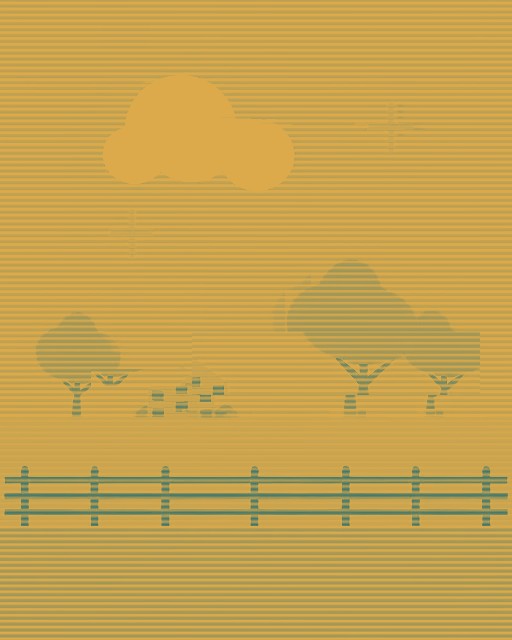
 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur Twitter
Partager sur Twitter Imprimer cet article
Imprimer cet article